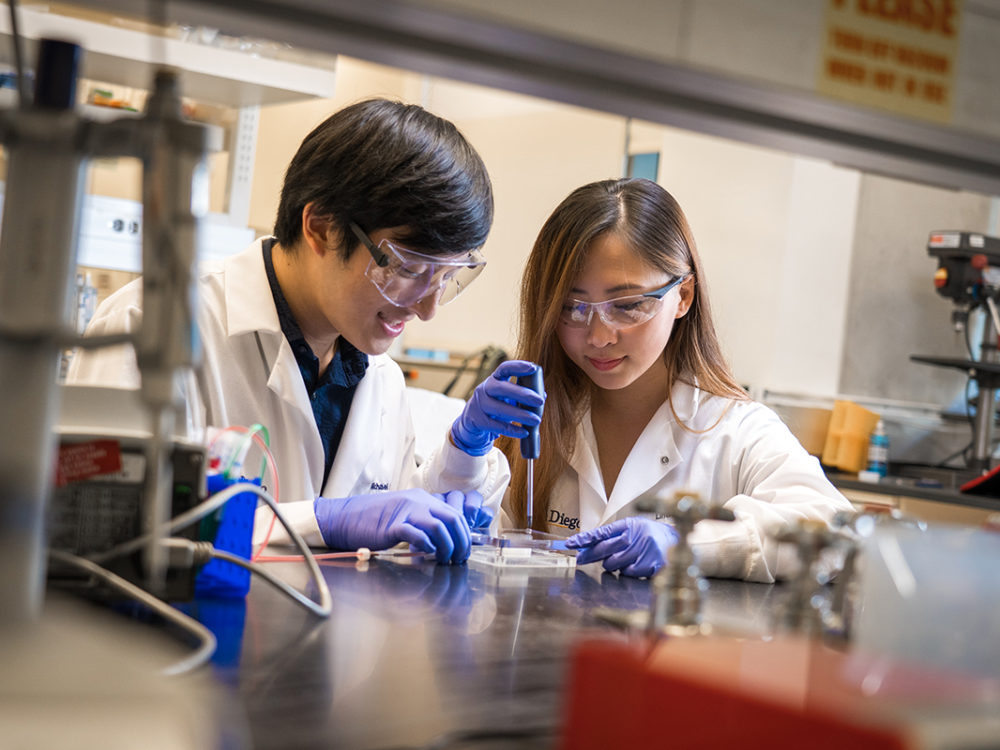La science en français recule et cela, même dans les universités canadiennes où l’on parle français. Les sciences naturelles se diffusent plus que jamais en anglais. Même les sciences humaines et sociales se laissent de plus en plus tenter par le bilinguisme et par l’anglais, à l’heure de la mondialisation.
« Nous ne sommes pas là pour combattre l’anglais, mais pour bonifier la science en français, particulièrement auprès de nos élus. Nous devons élargir notre rayon d’action aussi dans les collaborations, par exemple avec l’Afrique, où est le futur de la Francophonie », lançait Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec, en ouverture du récent Forum international sur la science en français, à Montréal.
Ce n’est pas le temps de baisser les bras, selon les nombreux experts réunis, mais d’améliorer la promotion et la « découvrabilité » des publications scientifiques en français, les soutenir financièrement et de manière pérenne, créer de nouvelles plateformes pour soutenir le plurilinguisme… Les chantiers s’annoncent nombreux.
Il y a peu de diffuseurs pour le savoir scientifique francophone d’ici et d’ailleurs. En porte-drapeau de cette francophonie savante, Érudit, la plateforme canadienne numérique de la recherche en sciences humaines et sociales accueille 5 millions de visiteurs annuels, compte 1200 bibliothèques partenaires et plus de 300 revues scientifiques et culturelles. La recherche scientifique canadienne y est également diffusée en anglais. Les participants du Forum étaient donc invités à se mettre en mode solution.
L’Afrique en tête
La Francophonie compte 321 millions de locuteurs à travers la planète. Pôle central, le continent africain est aujourd’hui fort de sa jeunesse et de sa démographie — on prévoit même la multiplication par deux de sa population, toutes langues confondues, pour atteindre 2 milliards de personnes en 2050.
L’Afrique compte de plus en plus de jeunes chercheurs, résultat d’un fort investissement dans l’éducation. La science en français s’y fait pourtant bien discrète, comme le rappelle Romain Murenzi, le directeur général de l’Académie mondiale des sciences, une organisation qui soutient la recherche scientifique dans les pays en développement, sous l’égide de l’UNESCO.
« Pourquoi investir dans la science et non dans l’agriculture ? Je dois toujours le rappeler : la science est la voie royale pour atteindre la croissance économique. La communication en langue française, et dans les autres langues locales, est le grand défi du Sud global », insiste celui qui, formé en télécommunications et en physique, a aussi été ministre des Sciences du Rwanda, et directeur de l’Association américaine pour l’avancement des sciences (AAAS).
Un des problèmes est que les chercheurs africains ne parviennent pas à publier dans les grandes revues. La recherche africaine est invisible : à peine 0,02 % des publications scientifiques. « C’est comme la pointe de l’iceberg. On ignore l’immense majorité des recherches scientifiques africaines », ajoute Mame-Penda Ba, doyenne adjointe de l’Université Gaston-Berger, au Sénégal.
Il faut donc rendre visible ce savoir. « Les chercheurs doivent pouvoir travailler en français, et dans leur langue d’appartenance, pour se réaliser et avancer, mais aussi pour favoriser la démocratisation des savoirs auprès de leurs populations », soulève M Murenzi.
La récente pandémie a d’ailleurs montré l’urgence de rendre accessibles les connaissances scientifiques à tous, dans une langue locale. « C’est devenu un besoin d’accéder facilement au savoir dans sa propre langue », soutient encore le directeur de l’Académie mondiale des sciences.
Alors que « l’Afrique représentera bientôt 75 % de la Francophonie, il est temps de multiplier les maillages avec les pays de ce continent et de mieux soutenir ses propres publications scientifiques », relève encore Mame-Penda Ba. Il importe pour cela de soutenir la jeune génération des chercheurs du Sud, comme l’affirmait Romain Murenzi, il y a déjà plus de dix ans.
Le projet d’édition électronique des revues scientifiques africaines, lancé par le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur, vise justement à rendre plus visible la production scientifique africaine.
Recul du savoir en français, même au Canada
Publier en anglais est souvent une question de prestige, de carrière et d’argent, au Canada comme ailleurs. « Il faut se poser la question s’il y a un capital symbolique plus grand à le faire en français », précise Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal et professeur titulaire au département de philosophie.
Dans ce monde globalisé, la recherche scientifique en français peine à prendre sa place dans la transmission des découvertes et les innovations. C’est le cas depuis longtemps pour les sciences naturelles et technologiques, là où la lingua franca est l’anglais, mais ça le devient aussi pour les sciences humaines et sociales.
Selon le titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante, Vincent Larivière, 86 % des 7,5 millions d’articles scientifiques mondiaux sont en anglais. Sur les 13 % qui restaient en 2018, on remarque une place notable pour le portugais, dont les publications sont soutenues par le gouvernement, et l’allemand, la langue de publication d’Einstein.
Vincent Larivière rappelle aussi que l’importance relative des langues autres que l’anglais ne cesse de reculer : 40 % des publications en 1955 contre 13 % en 2018. « Ce n’est pas un enjeu unique au français », note celui qui est aussi professeur agrégé à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal.
Au Canada, les revues bilingues et en français reculent aussi et les publications des universités francophones s’anglicisent. Même au sein des sciences sociales et humaines (philosophie, histoire du Québec, sociologie…), qui publient traditionnellement en français, le recul se fait sentir.
Et avec lui, la diffusion des résultats de recherche, l’archivage de connaissances, la fédération des communautés, etc. « Les revues ne sont pas toutes nées égales (langue, domaine, éditeur). Il y a un décalage entre ce qui est important et ce qui est pris en compte dans les évaluations », relève M. Larivière.
Ce constat est lié aux perspectives de carrière, mais aussi à la géographie — au Québec, c’est plus facile — et à l’appartenance à une université anglophone ou bilingue. « La langue de l’institution influence la langue de publication et ce qui se publie. Les deux tiers des publications scientifiques en français sont en sciences humaines contre 20 % pour les sciences naturelles », relève le directeur de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques de l’Université de Moncton, Éric Forgues.
Déjà, plus de 90 % des articles au Canada se publient en anglais. Et le recul se fait sentir partout : 70 % des publications en sciences humaines se font en anglais. Il n’y a que dans les arts et lettres que l’anglais est minoritaire, avec 30 % si l’on prend en compte la base de données d’Érudit.
Le Québec accueille 46 % des revues canadiennes francophones et bilingues, soit 120 sur 260. Mais si l’on ne calcule que les francophones, 85 % se trouvent au Québec (60 sur 71). Mais les revues en français ne représentent que 10 % des revues créées depuis les années 1960 au Canada.
Un sondage réalisé en 2020 auprès de 515 chercheurs d’expression française hors Québec montre que l’anglais attire de plus en plus. Les collaborations avec leurs collègues anglophones peuvent même parfois nuire à la volonté de poursuivre des travaux en français. On publie en anglais pour « rejoindre plus de monde, une plus grande crédibilité, faire avancer sa carrière, obtenir des subventions, être cité, etc. », énumère Éric Forgues.
Le nerf de la guerre, c’est l’argent, rappelle Jean-Christophe Bélisle-Pipon, de l’Université Simon-Fraser, en Colombie-Britannique. « J’essaie de monter une communauté de jeunes chercheurs francophones, mais l’essentiel de mon financement provient des États-Unis. Pour soutenir une recherche francophone hors Québec, l’argent manque. Il n’y a pas de programme pour ça », relève le jeune chercheur.
La piste de la diplomatie
La diplomatie scientifique en français gagne cependant du terrain. Ce jeune concept, apparu en 2010, explore les relations entre la science et la technologie d’un côté, et les affaires internationales de l’autre. En juin prochain, se déroulera d’ailleurs une école d’été sur la diplomatie scientifique à l’Université de Montréal.
Ce type de rayonnement du savoir scientifique en français prend la forme de regroupements de recherche internationaux, de partenariats et de coopération entre les pays.
« C’est quelque chose de très présent dans le monde anglophone », relevait Mathieu Ouimet, du Département de sciences politiques de l’Université Laval, dans le cadre d’un panel sur le conseil et la diplomatie scientifiques dans la Francophonie. « Cela existe aussi en français, mais cela n’est souvent pas identifié comme tel. Au Bénin, il se donne de nombreux conseils scientifiques aux politiciens avec un accès aux données probantes. »
Cette alliance entre scientifiques et politiciens vise aussi à améliorer les relations entre pays et à multiplier les maillages. « Cela nous aide à nous développer par le savoir et à régler les problèmes contemporains », soutient Slim Khalbous, recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie.
Présenté en octobre 2022 aux chefs d’État et de gouvernements présents au 18e Sommet de la Francophonie de Djerba (Tunisie), le Manifeste pour une diplomatie scientifique francophone a été signé par 40 pays. Ceux-ci s’engagent à promouvoir l’expertise francophone et le réseautage politico-scientifique.
Il s’agit un document centré sur l’apport des systèmes éducatifs et universitaires et porté par les décideurs politiques. « Les défis sont globaux et transfrontaliers », explique M. Khalbous.
Le manifeste priorise sept grands axes : institutionnaliser la mobilité des compétences, professionnaliser le corps enseignant et les diplômes, valoriser les publications scientifiques francophones, prôner la qualité des établissements scientifiques, démocratiser le numérique éducatif, développer l’employabilité des jeunes et promouvoir l’entrepreneuriat, diffuser la culture de la médiation et de la gestion de conflits.
« Il faut développer le capital humain en formant de nouveaux chercheurs francophones. Former une relève scientifique de qualité en français, mais aussi faire une place au plurilinguisme dans la francophonie », relève Zahra Kamil Ali, conseillère pour les Amériques de l’Organisation internationale de la Francophonie.
Pour lutter contre le fatalisme du recul du français et de l’attirance de l’anglais chez les jeunes générations, il faut développer des programmes attirants pour des carrières en français, mais aussi « multiplier les appels de projets et de solutions très rapidement applicables (3-6 mois) », croit M. Khalbous.
La consultante au sein de la division des Objectifs de développement durable, à l’Organisation des Nations unies, Nora Boudghène, est venue rappeler qu’une « langue est un véhicule de transfert de connaissances. Le français occupe un rôle primordial pour vulgariser la science et lutter contre la désinformation dans le contexte des crises globales que nous vivons. »
Une science plurilingue
Dès la première matinée du Forum sur la science en français, le 26 avril, une conférencière de la Suisse est venue rappeler l’importance du plurilinguisme. « La diversité des langues est capitale pour la science. La communication universelle s’avère une illusion qui provoque un appauvrissement des connaissances », insistait la linguiste Anne-Claude Berthoud, de l’Université de Lausanne. Cela donne une « McDonaldisation » de la science selon elle, répondant à la logique économique.
« Traduire en anglais, ce serait perdre du signifiant », ajoute-t-elle, citant le philosophe français FrançoisJullien, titulaire de la Chaire sur l’altérité de la Fondation de la Maison des sciences de l’homme (France).
« Construire du savoir dans notre langue maternelle est une richesse », rappelle le démographe de l’Université Laval, Richard Marcoux. Lorsque le savoir se construit, la découverte bénéficie de la proximité avec la langue et de la diversité de regards des chercheurs et des chercheuses. La science s’incarne alors à travers des échanges pluridisciplinaires et en diverses langues.
« Le plurilinguisme est l’antidote à l’écrasement des altérités scientifiques et académiques. La langue est une richesse qui assure la qualité des savoirs », ajoute même Mme Berthoud. Et le français occupe une riche place dans ce plurilinguisme des savoirs à inventer.
Des actions pour le français
Pour donner plus de visibilité au savoir scientifique en français, l’Agence universitaire de la Francophonie tiendra la 3e édition de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique du 30 octobre au 3 novembre 2023, à Québec.
Le problème est de faire venir des chercheurs et chercheuses d’Afrique. Les visas sont toujours difficiles à obtenir, sans compter le manque de soutien aux voyages professionnels. « Une des solutions simples serait de faciliter l’accès à l’Autorisation de voyage électronique (AVE) pour les scientifiques de la Francophonie. Pour l’instant, aucun des ressortissants des pays d’Afrique n’y a accès », insiste Richard Marcoux, démographe à l’Université Laval.
L’Acfas a de son côté créé un service d’appui à la recherche en français (SARF) et lancera bientôt une plateforme en ligne pour faciliter leur découvrabilité.
Pour cela, il faut augmenter l’indexation et l’archivage numérique. « Il faut également tirer profit de l’intelligence artificielle et accélérer les échanges en soutenant l’initiative de science ouverte en français. », soutient Christian Agbobli, vice-recteur à la recherche, la création et à la diffusion, de l’Université du Québec à Montréal.
Il faut encore que les bons ingrédients pour la survie des revues savantes soient présents et même qu’elles « soient heureuses », comme le soutiennent dans un article Émilie Paquin et de Suzanne Beth, directrice et chercheuse d’Érudit.
Les moyens financiers en tête, mais pas seulement, car « l’indice de bonheur » des revues se mesurerait par d’autres facteurs : bénéficier du soutien institutionnel, recrutement facile des évaluateurs, et bonne compréhension des changements de la publication savante, dont l’accès libre en tête.
Enfin, on a tendance à l’oublier, mais davantage de production scientifique en français peut aussi être un enjeu pour le citoyen, pas uniquement pour les chercheurs. C’est un enjeu de développement des collectivités.
Publier dans la langue locale permet de bâtir une société du savoir inclusive, accessible et bénéficiant à tous. Un participant rappelait les travaux de la regrettée Florence Piron sur la science comme bien commun, et l’importance des Éditions science et bien commun et Grenier des savoirs. Bientôt, le Prix Florence-Piron viendra récompenser deux étudiants d’Afrique ou d’Haïti contribuant à la recherche en sciences humaines.
Lien vers l’article original :
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2023/05/03/francophonie-scientifique-temps-alliances